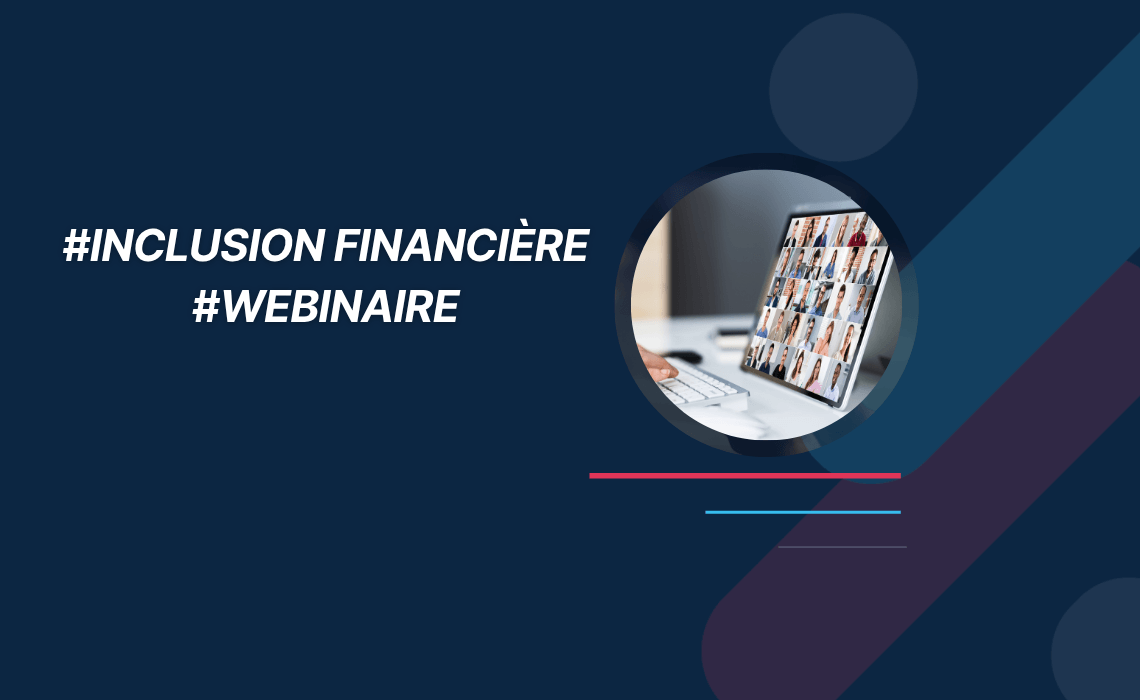Microfinance dans l’UEMOA : l’épreuve de la modernisation digitale et réglementaire
Après avoir connu son âge d’or au début des années 2000, le secteur de la microfinance gagne en maturité dans l’UEMOA. Entre réglementation incomplète, digitalisation accélérée, interopérabilité promise et consolidation du secteur, comment les institutions de microfinance naviguent-elles dans cette transformation ? Amaury Martin, consultant en finance inclusive, décrypte les mutations d’une microfinance à la croisée des chemins.
Apparue au Bangladesh dans les années 1970, la microfinance moderne que l’on connaît aujourd’hui a trouvé un terrain particulièrement fertile dans les huit pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.
La faible implantation bancaire traditionnelle – le taux de bancarisation n’atteint que 25,6 % dans les établissements classiques mais près de 48 % en incluant la microfinance [1] – conjuguée à l’essor du mobile money, a créé un écosystème favorable à ces institutions de proximité. La microfinance y concentre plus de 19,12 millions de clients, pour des encours de 2 459 milliards de francs CFA (3,75 milliards d’euros), des chiffres en progression régulière, avec respectivement +6 % de clients à fin 2024 et +8,1 % d’encours en glissement annuel [2].
Le secteur fait pourtant face à de nouveaux défis. La digitalisation reste encore bien inégale selon la taille des institutions et surtout, la réglementation de 2023, si elle a le mérite de simplifier le cadre global, présente des zones d’ombre créant un climat d’incertitude.
Quels sont les facteurs clefs qui expliquent le succès du microcrédit dans l’UEMOA ?
Amaury Martin : Les institutions de microfinance (IMF) se divisent en trois catégories : les petites institutions, souvent rurales et basées sur des fonctionnements communautaires comme les AVEC (Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit), très proches de la population, mais ce sont les établissements les plus à risque. Puis les IMF de taille intermédiaire, et enfin les grandes IMF pouvant être présentes dans plusieurs pays, avec des agences plutôt en zone urbaine et plus développées sur le plan digital.
Le succès de la microfinance s’explique par ce qui la différencie de la banque traditionnelle : une relation client avec une proximité très forte. Les remboursements se font souvent de manière journalière ou hebdomadaire, avec des systèmes de tontines. Les IMF doivent donc déployer un réseau d’agent de terrain capable d’aller à la rencontre des clients très fréquemment. Ces agents se déplacent la plupart du temps à moto, sillonnant les villages et les marchés. L’humain est ainsi au cœur du modèle.
Cette approche explique d’ailleurs des taux d’intérêt élevés pour couvrir le risque important du modèle et les charges opérationnelles élevées par rapport aux montant des crédits liée à la mobilité et l’accessibilité dont doivent faire preuve les agents. Les taux sont plafonnés dans la zone à 24 % annuel et la plupart des IMF s’alignent sur cette limite.
Comment les institutions parviennent-elles à gérer les risques de crédit tout en maintenant l’accessibilité du microcrédit ?
Amaury Martin : Le risque de non-remboursement est le risque principal. L’indicateur clef est le portefeuille à risque (PAR), particulièrement le PAR 30 qui mesure les retards de paiement de plus de 30 jours. La réglementation prudentielle exige de constituer des réserves comptables pour l’intégralité de ce portefeuille à risque.
Au-delà des aspects comptables, connaître sa clientèle est essentiel. Il faut être au plus proche et bien connaître les territoires couverts pour anticiper d’autres risques comme les inondations, une forte sécheresse, des incidents sur des infrastructures, etc. Toutes les institutions ne présentent pas forcément un département ou un responsable de gestion de risques, alors que c’est un élément crucial à mettre en place.
Pour maintenir l’accessibilité tout en couvrant les risques, plusieurs solutions existent : les micro-assurances proposées aux clients, les assurances de portefeuille que les IMF peuvent directement souscrire et les mécanismes de garantie mis en place par des fonds d’investissement ou des agences de développement comme l’AFD. Ces mécanismes permettent aux IMF de prendre plus de risques que ce qu’elles auraient pu se permettre en étant seules.
Où en est la digitalisation du secteur ?
Amaury Martin : Il s’agit d’un grand chantier encore en construction. Certaines institutions, notamment les grandes, ont très bien pris le cap de la transformation digitale avec la mise en place d’applications ou la prise en charge du canal USSD. Ce protocole permet d’accéder aux services financiers sans smartphone ni connexion internet grâce à des codes courts (exemple : *123*1#). L’USSD reste prépondérant, notamment pour la mobile money qui est vraiment spécifique au continent africain. Les applications mobiles ont quant à elles l’avantage d’être plus ergonomiques. Néanmoins leur accessibilité est encore relative bien que la pénétration du smartphone dans l’UEMOA soit en croissance.
Le numérique présente un énorme atout. Il permet de pallier les coûts de déplacement et plus la clientèle est éloignée, plus cela devient intéressant. Néanmoins, cette clientèle plus rurale est aussi souvent la moins connectée. De gros enjeux de modernisation demeurent donc. Une solution réside dans la présence d’agents relais : des petits kiosques qui parsèment les villes et villages et permettent le dépôt-retrait de mobile money ainsi que la réalisation de certaines opérations de microfinance.
Que change concrètement la nouvelle loi uniforme de 2023 ?
Amaury Martin : Cette réglementation a le mérite de libéraliser certains aspects de la microfinance tout en imposant un cadre strict. Deux formes juridiques de sociétés sont désormais autorisées pour les IMF : la société anonyme (SA) et la société coopérative avec conseil d’administration (COOP-CA). Les SARL, ONG et associations sont désormais interdites et devront se transformer.
Sur le plan digital, la réglementation exige trois conditions : que le logiciel fournisse l’information en « temps opportun », qu’il puisse se connecter à la plateforme d’interopérabilité – qui nous le verrons n’est pas encore active – et qu’il soit relié au Bureau d’Information sur Crédit (BIC). Cette troisième condition vise à mieux déterminer la solvabilité des emprunteurs et éviter le phénomène de « cavalerie », par lequel un client souscrit un nouvel emprunt pour rembourser un crédit antérieur. Elle renforce aussi la gouvernance, le contrôle interne et la protection des clients : impératifs de délivrer une information claire, de prendre des mesures pour éviter le surendettement, assurer la gestion des plaintes, etc.
D’autres éléments sont en revanche très flous, comme l’introduction d’un capital minimum obligatoire pour les IMF – qui n’existait pas avant – mais dont le montant n’est pas encore précisé et qui préoccupe fortement le secteur. Au Bénin, où j’ai effectué plusieurs missions sur le sujet, le capital moyen des IMF coopératives est de l’ordre des 140 millions de FCFA. Si la réglementation venait à exiger un capital minimum obligatoire de 500 millions ou 1 milliard de FCFA, par exemple, c’est tout un pan du secteur local qui pourrait disparaître ou devoir se transformer.
De mon point de vue et en l’absence de précision, il ressort de l’esprit des textes que la réglementation interdit aux IMF d’être petites. Or, une IMF peut tout à fait être petite mais s’avérer très efficace sur le plan opérationnel et dans ses résultats. Les petites structures ont beaucoup à apporter en microfinance et ont tout à fait leur place.
L’interopérabilité bancaire représente-t-elle vraiment une opportunité ?
Amaury Martin : Des initiatives d’interopérabilité bilatérales existent entre certains services de banques, mobile money et microfinance, mais l’idée est de centraliser le système dans son ensemble autour d’un même noyau. Sur le principe, l’interopérabilité serait une avancée majeure en permettant de relier les comptes bancaires, de microfinance et de mobile money pour que tous soient interconnectés. Cela permettrait de faire tout type de transactions quelle que soit l’institution. Les opportunités économiques sont réelles puisque cela facilite et multiplie les transactions. Ces dernières étant bien entendu assorties de frais, cela rapporterait de l’argent aux institutions financières.
Dans les faits, nous sommes encore au stade de projet et les avancées sont très confidentielles. D’un point de vue purement technique, l’interopérabilité n’a pour autant rien d’insurmontable. Ce qui l’est davantage, c’est de mettre d’accord tous les acteurs de l’écosystème financier concerné sur les modalités – frais, commissions, etc. Et enfin, qu’ils soient en mesure de se connecter à la plateforme, chacun selon son niveau de développement digital !
Comment voyez-vous évoluer la microfinance dans les prochaines années ?
Amaury Martin : Il y a des tendances dans la microfinance. Au début des années 2000 jusqu’en 2010 environ, la performance sociale primait. A cet aspect, toujours bien ancré dans la microfinance, s’ajoute désormais la vague de la digitalisation. Les bases sont posées pour les grandes institutions, mais il faut que tout le monde se mette à niveau.
Autres vagues qui montent, la finance verte et la finance de « genre » qui se focalise sur l’accès du financement pour les femmes. Les considérations écologiques sont croissantes, avec plusieurs dimensions : éviter de nuire à l’environnement, la mitigation pour éviter d’émettre du CO2 et l’adaptation aux changements climatiques. Si ces sujets relèvent encore de l’ordre des bonnes pratiques, ils pourraient être la prochaine grande évolution du secteur.
Sur le chantier de la digitalisation relancé avec la nouvelle réglementation, on peut espérer que XLOAN sera en mesure de proposer des solutions.
Xloan est une plateforme de gestion de financement et, à ce titre, équipe déjà des acteurs majeurs du microcrédit en France, notamment l’IMC, Institut de Microcrédit des Caisses d’Épargne. Au cœur des processus de digitalisation et plus récemment des usages de l’intelligence artificielle, XLOAN accompagne des acteurs du financement de la zone UEMOA. C’est donc en alliant son expertise technologique, son expertise du microcrédit et sa présence locale que Xloan est, aujourd’hui, un acteur incontournable.
Face à ces transformations multiples – réglementaires, technologiques et environnementales – la microfinance ouest-africaine saura-t-elle préserver son essence de proximité tout en s’adaptant aux exigences de modernisation ?
[1] Tableau de bord de l’inclusion financière dans l’UEMOA au titre de l’année 2023 – août 2024
[2] Situation de la microfinance dans l’UMOA au 31 décembre 2024, avril 2025, BCEAO